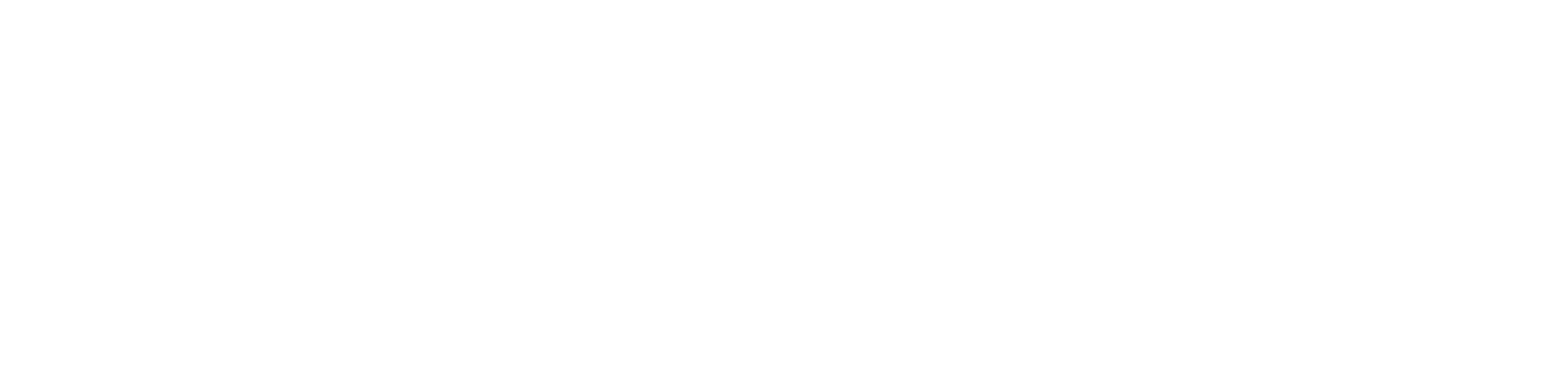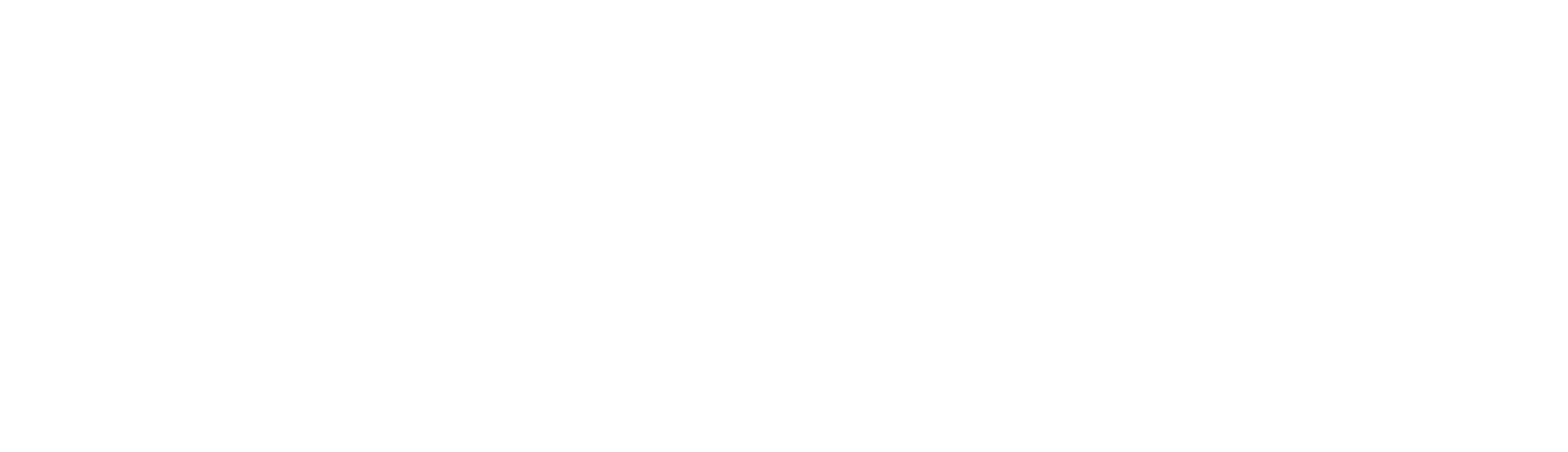Yazid Ier (mort en 683) est le fils de Muʿâwiya Ier et le second calife de la dynastie omeyyade. Son accession au pouvoir marque l’introduction de la succession héréditaire dans le califat, ce que refusent de nombreux musulmans, notamment Husayn, fils d’Ali. Sous son règne se produit le massacre de Kerbala, qui aura des conséquences irréversibles sur la division entre…Lire la suiteYazid Ier
Pantopique : 600-700
Un pantopique correspond à la réunion de quelques repères, plus ou moins nombreux, que vous pouvez commenter, compléter, étendre, selon vos propres champs d’expériences, de savoirs, d’enquêtes… - contact@21dialogues21.org
Kerbala, ville d’Irak, est le théâtre en 680 d’un événement fondateur du chiisme : le massacre de l’Imam Husayn, petit-fils du Prophète, et de ses partisans par les troupes de Yazid Ier, calife omeyyade. Husayn avait refusé de prêter allégeance à Yazid, jugeant son pouvoir illégitime. Il est tué avec 72 compagnons, dont son fils Ali al-Akbar, après un siège…Lire la suiteKerbala
Ali ibn Abî Tâlib (600–661) est le cousin et gendre du Prophète Mohammed. Il est le quatrième calife des sunnites et le premier imam pour les chiites. Il épouse Fâtima, fille du Prophète, et devient père de Hassan et Husayn. Sa bravoure au combat (notamment à Badr et Uhud) est légendaire. Après l’assassinat du calife Uthmân, Ali est élu calife,…Lire la suiteAli ibn Abî Tâlib
Fâtima bint Mohammed (vers 605–632) est la fille cadette du Prophète et de Khadîja. Elle épouse Ali ibn Abî Tâlib, cousin du Prophète, et devient la mère de Hassan et Husayn, figures majeures du chiisme. Elle est un modèle de piété, de modestie et de fidélité en islam. Elle est parfois surnommée al-Zahrâ’ (« la Lumineuse »). Les chiites lui…Lire la suiteFâtima bint Mohammed
Muʿâwiya Ier (602–680), gouverneur de Syrie, devient en 661 le premier calife de la dynastie omeyyade. Il s’oppose à Ali, quatrième calife bien guidé et cousin du Prophète, à la suite de l’assassinat du calife Uthman. La bataille de Siffin (657) entre Ali et Muʿâwiya déclenche une grande discorde : la fitna. En 661, après l’assassinat d’Ali, Muʿâwiya s’impose comme…Lire la suiteMuʿâwiya Ier
La dynastie Táng est l’une des plus brillantes de l’histoire impériale chinoise. Elle règne de 618 à 907, avec capitale à Chang’an, alors l’une des plus grandes métropoles du monde. Sous les Táng, la Chine connaît une prospérité économique, une stabilité politique, et un épanouissement culturel sans précédent. L’empire s’ouvre largement vers l’extérieur : la route de la soie permet…Lire la suiteDynastie Táng
La dynastie sassanide règne sur la Perse de 224 à 651 apr. J.-C., succédant aux Parthes. Son fondateur, Ardashir Ier, établit une monarchie centralisée et rétablit le zoroastrisme comme religion d’État. Le territoire s’étend de la Mésopotamie à l’Indus. C’est une époque de renaissance culturelle, scientifique et artistique iranienne : architecture monumentale, littérature en moyen-perse (Pahlavi), philosophie. Les Sassanides affrontent…Lire la suiteDynastie sassanide
Fondée en 670, la ville de Kairouan a prospéré sous la dynastie aghlabide, au IXe siècle. Malgré le transfert de la capitale politique à Tunis au XIIe siècle, Kairouan est restée la première ville sainte du Maghreb. Son riche patrimoine architectural comprend notamment la Grande Mosquée, avec ses colonnes de marbre et de porphyre, et la mosquée des Trois-Portes qui…Lire la suiteKairouan
Situé sur les rives de la Volga, au sud de sa confluence avec la rivière Kama et de la capitale du Tatarstan, Kazan, Bolgar est un établissement de la civilisation nomade des Bulgares de la Volga – qui exista du VIIe au XVe siècle –, et il fut la première capitale de la Horde d’or au XIIIe siècle. Les vestiges…Lire la suiteL’ensemble historique et archéologique de Bolgar
La ville historique de Samarkand représente un carrefour et un lieu de synthèse des cultures du monde entier. Fondée au VIIe siècle avant l’ère chrétienne sous le nom d’Afrasyab, Samarkand connut son apogée à l’époque timouride, du XIVe au XVe siècle. Les principaux monuments comprennent la mosquée et les médersas du Registan, la mosquée de Bibi-Khanum, l’ensemble de Shah i-Zinda…Lire la suiteSamarkand – carrefour de cultures
La ville maya d’Uxmal, dans le Yucatan, a été fondée vers l’an 700 et compta jusqu’à 25 000 habitants. Construits entre 700 et 1000, ses édifices sont disposés en fonction de données astronomiques. La pyramide du Devin, ainsi nommée par les Espagnols, domine l’espace des cérémonies composé de bâtiments d’une architecture soignée, richement décorés de motifs symboliques et ornés de…Lire la suiteVille précolombienne d’Uxmal
Xochicalco est un exemple particulièrement bien préservé d’un centre politique, religieux et commercial fortifié de la période trouble qui va de 650 à 900 et qui suit l’effondrement des grands États méso-américains, tels Teotihuacan, Monte Albán, Palenque et Tikal.Lire la suiteZone de monuments archéologiques de Xochicalco
Les monuments bouddhiques du Horyu-ji, dans la préfecture de Nara, sont au nombre de 48. Certains édifices construits à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle comptent parmi les plus anciens bâtiments de bois subsistant dans le monde. Chefs-d’œuvre de l’architecture en bois, ils ont marqué une période importante de l’histoire de l’art, illustrant en effet l’adaptation…Lire la suiteMonuments bouddhiques de la région d’Horyu-ji
Les Ensembles monastiques arméniens de l’Iran, au nord-ouest du pays comprennent trois ensembles monastiques historiques de la foi chrétienne arménienne : St-Thaddeus, St-Stepanos et la chapelle Ste-Marie de Dzordzor. Ces édifices, dont le plus ancien, St-Thaddeus, date du VIIème siècle, sont des exemples de valeur universelle exceptionnelle des traditions architecturale et décorative arméniennes. Ils montrent également les très importants échanges…Lire la suiteEnsembles monastiques arméniens de l’Iran
Bam et son paysage culturel s’inscrivent dans un environnement désertique, à la lisière sud du haut plateau iranien. On peut retracer les origines de Bam jusqu’à la période achéménide (VIe au IVe siècle av. J.-C.). Située au carrefour d’importantes routes marchandes et réputée pour la production de soie et de vêtements de coton, elle connut son apogée du VIIe au…Lire la suiteBam et son paysage culturel
Cet ensemble de sanctuaires, dû aux souverains Pallava, fut creusé dans le roc et construit aux VIIe et VIIIe siècles sur la côte de Coromandel. Il comprend notamment des rathas (temples en forme de chars), des mandapas (sanctuaires rupestres), de gigantesques reliefs en plein air, comme la célèbre « Descente du Gange », et le temple du Rivage, aux milliers…Lire la suiteEnsemble de monuments de Mahabalipuram
Les zones historiques de Gyeongju contiennent une remarquable concentration d’exemples exceptionnels de l’art bouddhiste coréen sous forme de sculptures, de reliefs, de pagodes et de vestiges de temples et de palais datant de la période qui a vu s’épanouir cette forme d’expression artistique unique, en particulier du VIIe au Xe siècle.Lire la suiteZones historiques de Gyeongju
Les Sansa sont des monastères bouddhistes de montagne disséminés dans les provinces méridionales de la péninsule coréenne. L’aménagement spatial des sept temples qui composent le bien, fondés du VIIe au IXe siècle, présente des traits communs qui sont spécifiques à la Corée – le madang (cour ouverte) entouré de quatre bâtiments (salle du Bouddha, pavillon, salle de lecture et dortoir).…Lire la suiteSansa, monastères bouddhistes de montagne en Corée
Témoin de l’essor du bouddhisme du Mahayana au Bengale à partir du VIIe siècle, cet ensemble, connu sous le nom de Somapura Mahvira, le « grand monastère », a été un centre intellectuel de renom jusqu’au XIIe siècle. Par son plan parfaitement adapté à sa fonction religieuse, cette ville-monastère représente une réalisation artistique unique qui a influencé l’architecture bouddhique jusqu’au…Lire la suiteRuines du Vihara bouddhique de Paharpur
Sur la rive orientale de la mer Rouge, Djedda a été à partir du VIIe siècle l’un des ports les plus importants sur les routes commerciales de l’océan Indien. C’est ici qu’arrivaient les marchandises à destination de La Mecque. C’était aussi le port d’arrivée pour les pèlerins voyageant par la mer. Ce double rôle a permis le développement d’une ville…Lire la suiteVille historique de Djeddah, la porte de La Mecque